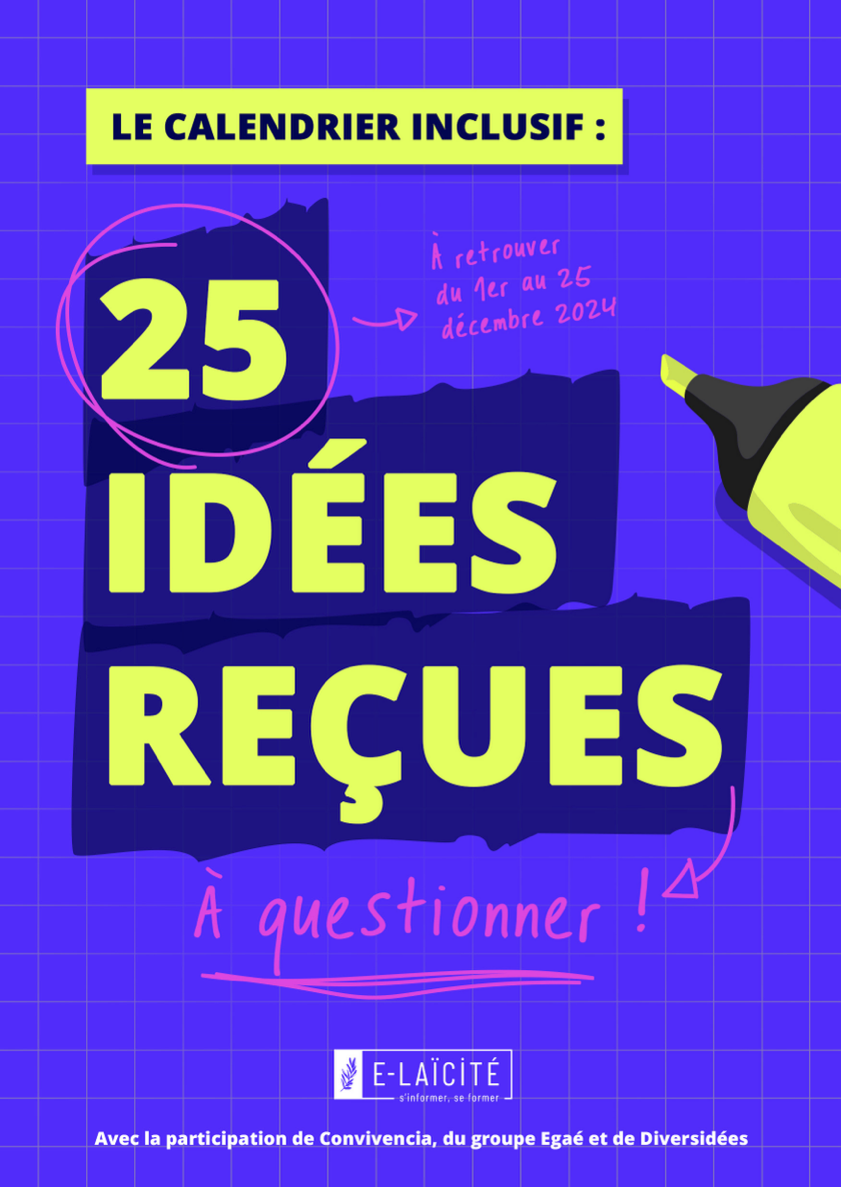Faire du prosélytisme au travail : une aberration ? Tour d’horizon du cadre applicable (privé/public) et exemples concrets de jurisprudence.
 En une vingtaine d’années à peine, l’essor fulgurant des politiques de « promotion de la diversité » au travail a modifié en profondeur la manière d’appréhender les inégalités en France.
En une vingtaine d’années à peine, l’essor fulgurant des politiques de « promotion de la diversité » au travail a modifié en profondeur la manière d’appréhender les inégalités en France.
C’est à travers des initiatives comme la Charte de la diversité en 2004 ou le Label Diversité en 2008, que le paradigme de la diversité s’est peu à peu imposé comme une évidence managériale. Alors que la France venait de se doter, avec les lois de 2001 et de 2004, d’un arsenal juridique renforcé pour lutter contre les discriminations, le discours sur la diversité promet de rompre avec la supposée « logique de culpabilité » de ce cadre jugé « contre-productif ».
Ainsi, la promotion de la diversité se veut positive et non-contraignante : n’existant que par la volonté des employeurs, elle repose sur un argumentaire – notamment popularisé par le rapport « Diversity wins » du cabinet McKinsey – qui vante les bénéfices de la diversité pour l’attractivité, l’image et la performance des organisations.
Ce glissement du juste vers l’utile n’est pourtant pas sans conséquence, si bien qu’une question se pose avec de plus en plus d’acuité : l’accent mis sur la promotion de la diversité au travail pourrait-il avoir entravé les efforts de lutte contre les discriminations ?
De la non-discrimination à la diversité : un glissement sémantique
Le paradigme de la diversité tire sa force de séduction de sa plus grande faiblesse : son imprécision. Contrairement à la notion de « discrimination », qui s’appuie sur une définition juridique précise et opposable, la diversité n’a presque aucun fondement légal en France. Elle n’implique donc « aucune obligation pour les employeurs » et ne « confère aucun droit aux salariés ou fonctionnaires éventuellement ciblés » par des inégalités de traitement, selon le Défenseur des droits.
Cette plasticité a favorisé l’essor d’un « droit souple » (soft law), qui s’est traduit par la multiplication des chartes, labels, guides internes et codes de conduite au sein des organisations. Ce foisonnement d’outils, facultatifs et non-contraignants, a pu entretenir l’illusion d’une résolution des enjeux liés à la diversité, freinant ainsi l’émergence de réglementations égalitaires plus exigeantes.
En effet, le terme diversité fonctionne parfois comme un « mot-écran », qui camoufle les discriminations en reformulant les enjeux : il ne s’agit plus de réparer une injustice, mais plutôt de valoriser une ressource. Or, en remplaçant le vocabulaire du droit par celui du management, on en vient à « gommer la question de l’auteur ou de la source de la discrimination ». Ce discours inverse même la logique de l’action : alors que la lutte contre les discriminations visait à protéger les minorisés, « la diversité devient un enrichissement collectif qui s’ancre dans l’intérêt de la majorité ».
Le pari risqué du « business case » pour la diversité
Ce glissement s’est accompagné d’une logique utilitariste : la diversité est promue non plus au nom de la justice sociale, mais pour ses bénéfices économiques. Ce passage « du juste à l’utile », s’il a pu convaincre certains acteurs initialement réticents, rend l’engagement des employeurs fragile par nature. Cette logique conduit en réalité à une instrumentalisation de la diversité, envisagée principalement comme un levier de performance au service des organisations.
Comme le note le Défenseur des droits, cette approche tend à « conditionner le respect des droits fondamentaux aux objectifs d’efficacité économique ». La loi devient ainsi relative, son application « subordonnée à la démonstration de son utilité mercantile ». Or, le lien entre non-discrimination et performance n’est pas systématique ; il peut même être questionné lorsque les préjugés de la clientèle entrent en jeu, par exemple. Comment assurer alors la pérennité de l’action ? Si la conjoncture se dégrade ou si la diversité n’est plus perçue comme un avantage concurrentiel, la justification de l’engagement risque en effet de s’effondrer.
Diversité des équipes : un gage de non-discrimination ?
Une idée reçue voudrait qu’une organisation diversifiée devienne naturellement non-discriminante. Or, celle-ci repose sur une vision simpliste des mécanismes discriminatoires, que plusieurs travaux sont venus battre en brèche. Tout d’abord, une politique de diversité peut tout à fait coexister avec des pratiques discriminatoires. Une entreprise très engagée pour l’emploi des seniors n’est pas pour autant à l’abri de négliger, par exemple, les enjeux d’égalité femmes-hommes.
Il arrive même que l’invocation de la diversité serve d’alibi pour des traitements discriminatoires. Ainsi, la justice a été saisie en 2006 du refus d’embauche d’une candidate d’origine maghrébine, justifié par la gérante d’un salon de coiffure au motif qu’« ayant déjà une employée indienne, elle ne pouvait pas vis-à-vis de la clientèle, se permettre d’employer exclusivement des personnes d’origine étrangère ».
Par ailleurs, les biais inconscients sont universels. L’idée que les personnes issues de groupes minorisés seraient, par expérience, moins enclines à discriminer ne se vérifie pas. Une enquête américaine a ainsi montré que l’ethnicité des chauffeurs de taxi n’avait « aucun impact sur la probabilité » qu’ils refusent des clients noirs.
Enfin, des mécanismes de conformisme comme l’« altérisation défensive » (defensive othering), peuvent conduire des personnes minorisées à adopter elles aussi un comportement discriminatoire. La diversité des équipes, si elle est un indicateur important, est donc insuffisante pour garantir l’égalité.
Faut-il renoncer à promouvoir la diversité au travail ?
Il ne s’agit pas de tirer un trait sur les politiques de promotion de la diversité, mais simplement de rappeler qu’elles ne peuvent pas suffire : une action efficace en faveur de l’égalité réelle au travail doit se fonder sur le droit et sur des évolutions concrètes des organisations.
Si la sensibilisation des dirigeant·es et managers est un préalable, son efficacité reste en effet limitée sans mesures structurelles. La véritable transformation ne vient pas seulement d’un changement des mentalités, mais d’une modification des procédures qui contraignent les pratiques. Il s’agit de bâtir une organisation qui, par ses règles de fonctionnement, rend les préjugés inopérants.
L’opacité étant le terreau de l’arbitraire, la transparence et la formalisation des décisions sont des leviers majeurs. Par exemple, dans le domaine du recrutement, des outils concrets permettent d’objectiver les décisions :
- La définition préalable des critères de recrutement : Elle vise à éviter que des justifications à une décision contestée ne puissent être fabriquées a posteriori.
- Le CV anonyme : Il permet de neutraliser les biais lors de la présélection en masquant les informations non pertinentes (nom, origine, âge).
- La Méthode de recrutement par simulation (MRS) : Elle évalue les « habiletés » concrètes via des mises en situation, contournant les prérequis de diplôme ou d’expérience.
- Le double regard et les grilles d’entretien standardisées : La conduite d’entretiens en binôme, fondée sur une grille standardisée, favorise l’équité et l’objectivité dans la prise de décision.
De la diversité à l’inclusion, une réelle transformation ?
En définitive, la promotion de la diversité au travail, malgré ses dimensions vertueuses, semble faire peser un risque sur l’atteinte de l’égalité réelle si elle ne va pas de pair avec une politique déterminée de lutte contre les discriminations. Celle-ci doit se traduire par des actions proactives, fondées en droit et ancrées dans les procédures organisationnelles, car les instruments de « droit souple » prouvent surtout leur efficacité lorsqu’ils « sont suscités et encadrés par des normes prescriptrices ».
On remarque enfin que ces dernières années, le discours sur la diversité au travail s’est enrichi de la promotion de l’« inclusion », qui vise plus haut que la simple représentativité des équipes. C’est à la qualité de l’intégration de chacun·e, au sein des collectifs de travail, que s’intéresse une démarche d’inclusion. Pour autant, inclusion et diversité partagent la même faiblesse : sans fondement en droit, elles dépendent du bon vouloir des employeurs et se voient tout autant soumises aux aléas conjoncturels, qu’ils soient économiques ou politiques.