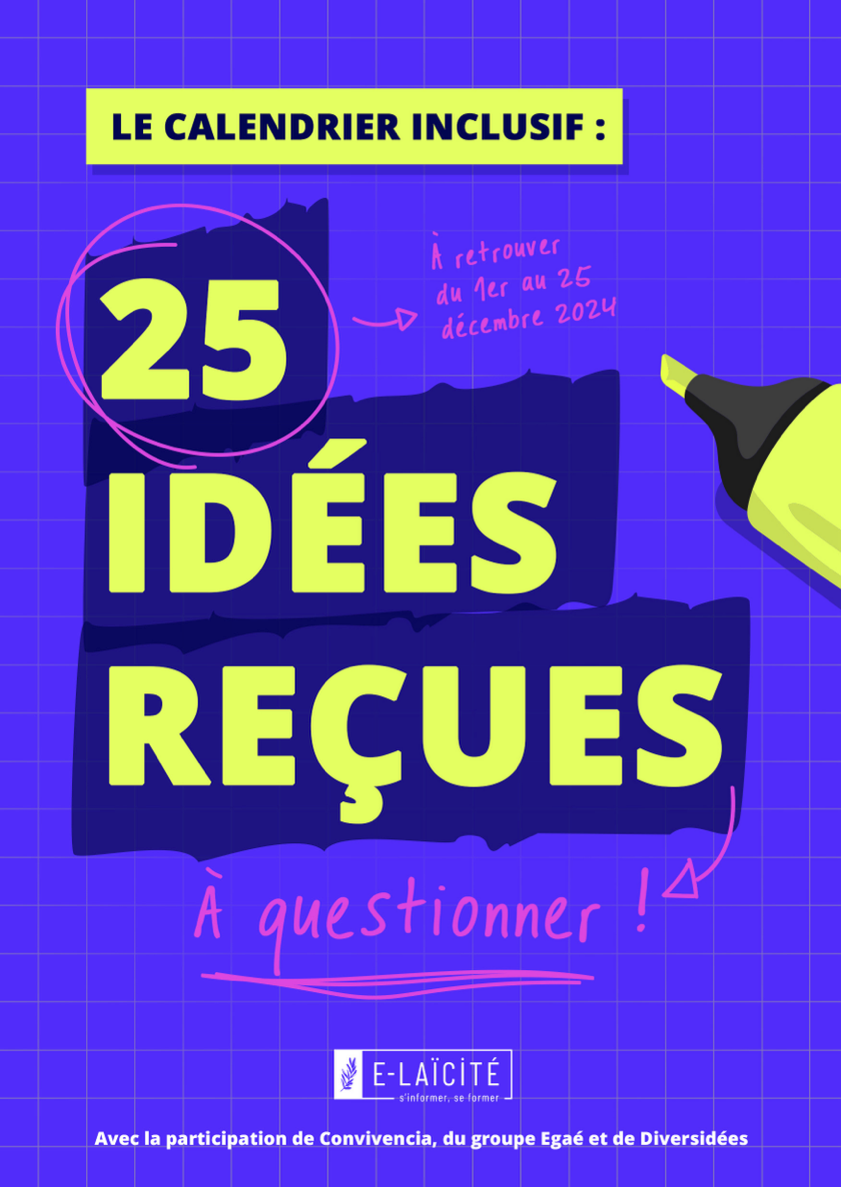La promotion de la diversité au travail suffit-elle à prévenir les discriminations ? Rien n'est moins sûr ! Analyse, exemples et conseils concrets.
 De plus en plus présents dans les organisations publiques comme privées, les réseaux internes d’allié·es – aussi appelés Employee resource groups (ERG) – jouent un rôle clé dans la transformation des cultures professionnelles vers une meilleure inclusion des diversités. Nés pour offrir des espaces de soutien et d’échanges, ils fédèrent les employé·es volontaires autour d’une cause commune et font progresser l’équité dans leurs organisations.
De plus en plus présents dans les organisations publiques comme privées, les réseaux internes d’allié·es – aussi appelés Employee resource groups (ERG) – jouent un rôle clé dans la transformation des cultures professionnelles vers une meilleure inclusion des diversités. Nés pour offrir des espaces de soutien et d’échanges, ils fédèrent les employé·es volontaires autour d’une cause commune et font progresser l’équité dans leurs organisations.
Une pratique importée qui s’est ancrée en France
Les réseaux internes sont apparus dans les années 1970 aux États-Unis, dans le sillage des mouvements pour les droits civiques. Le National Black Employee Caucus, premier ERG connu, avait ainsi été fondé au sein de l’entreprise Xerox pour soutenir ses employé·es afro-américain·es. Originellement axé sur la diversité ethnique, ce modèle de collectif s’est depuis étendu à de nombreux autres enjeux : genre, orientation sexuelle, handicap, mais aussi parentalité ou intergénérationnel. En France, on a vu émerger de premières initiatives dès le tournant des années 2000, notamment avec Personn’Ailes chez Air France ou EAGLE chez IBM.
Le rôle des réseaux internes est tout d’abord d’offrir un espace de soutien et de confiance aux personnes concernées, souvent confrontées à l’isolement ou à des obstacles dans leur carrière. Ces réseaux contribuent aussi à sensibiliser l’ensemble des équipes, participant ainsi à lutter contre les stéréotypes et les discriminations au travail.
Mais leur mission va plus loin : en formulant des recommandations concrètes ou en co-construisant des outils RH, les réseaux internes d’allié·es influencent directement les politiques internes. Comme le souligne un salarié engagé chez Accor :
« Faire de la communication, c’est très bien. Mais l’objectif d’un ERG est d’aller au-delà, à savoir d’obtenir des avancées concrètes. »
S’inscrire dans la durée : quelles sont les clés du succès ?
Créer des réseaux internes efficaces suppose toutefois de réunir quelques conditions. La première est l’engagement et le soutien de la direction : certains employeurs permettent ainsi à leurs membres d’ERG de consacrer du temps de travail à l’animation du collectif, d’autres leur allouent même un budget dédié. Heineken France finance ainsi son réseau Open & Proud pour soutenir ses actions en faveur des salarié·es LGBTQI+.
La structuration constitue un autre facteur déterminant : un noyau de membres actifs, une feuille de route claire et un·e sponsor issu·e du top management permettent d’ancrer durablement l’initiative. Pour éviter l’essoufflement, il faut par ailleurs veiller à l’animation permanente du réseau : réunions régulières, actions de sensibilisation, partenariats externes, etc.
Enfin, l’ouverture aux allié·es – c’est-à-dire des collègues qui ne sont pas directement concerné·es mais soutiennent la cause du réseau – renforce l’impact et la légitimité de ces collectifs.
Une diversité d’initiatives en France
L’égalité femmes-hommes est l’un des thèmes les plus représentés : par exemple, à la Caisse des Dépôts, le réseau Alter-Égales agit depuis 2011 pour favoriser la progression des femmes à tous les niveaux hiérarchiques. Dans le secteur privé, on trouve également de nombreux exemples de réseaux internes féminins comme Bouygt’elles chez Bouygues Telecom, Riise chez Accor, ou encore Énergies Mixité chez EDF.
Le champ LGBTQI+ est également bien représenté. Dans la fonction publique, FLAG! regroupe depuis 2001 des agent·es des forces de l’ordre, tandis qu’à la RATP, l’association Homobilités mène depuis 2003 des actions de sensibilisation et de convivialité. France Télévisions a créé en 2019 France·tv pour tou·te·s, qui œuvre pour la juste représentation des personnes LGBTQI+ à la fois en interne et dans les programmes diffusés sur les chaînes du Groupe.
Dans le secteur privé aussi, les exemples se multiplient : Mobilisnoo chez Orange, Gare! à la SNCF, Out@L’Oréal au sein du groupe de cosmétiques, ou encore LGBT+ Friends chez Engie. Ces réseaux participent aux Marches des fiertés, proposent un soutien aux personnes victimes de discriminations et travaillent avec les directions sur les politiques RH.
Bien que le sujet de la diversité d’origine reste sensible en France, des réseaux émergent : ainsi, BNP Paribas a créé le réseau CulturALL pour valoriser la diversité culturelle et lutter contre les discriminations liées aux origines, et Sanofi dispose d’un réseau dédié à la diversité ethno-culturelle parmi ses cinq ERGs en France.
En matière de handicap, le réseau Ability a été lancé chez BNP Paribas en 2020, pour briser les tabous et accompagner les collaborateur·ices concerné·es par le handicap visible ou invisible.
Enfin, certains réseaux internes portent sur les parcours de vie. On trouve ainsi plusieurs réseaux destinés aux jeunes, comme le Young Professionals Network (YPN) d’Engie ou Millennials@IBM, qui visent à accompagner les moins de 35 ans dans leur découverte du monde professionnel. Et depuis quelques années, on voit apparaître des réseaux consacrés aux enjeux de la parentalité : Criteo a inauguré en 2021 sa Parents Community, destinée à accompagner les jeunes parents et à faire entendre leurs besoins auprès de l’entreprise, et Imerys a suivi avec son réseau « New Parents ».
L’impact des réseaux internes : une transformation culturelle
Les réseaux internes ne remplacent pas les politiques de diversité et d’inclusion menées par les directions, mais ils en sont un prolongement vivant et un moteur de développement. En donnant la parole aux personnes concernées, en impliquant leurs allié·es et en formulant des recommandations concrètes, ils transforment la culture interne des organisations de l’intérieur.
Pour les employeurs, ces réseaux sont aussi un atout en matière d’attractivité et de fidélisation des talents. Pour les employé·es, ils représentent un espace de solidarité, de reconnaissance et de lutte pour l’équité et le respect de chacun·e au quotidien.