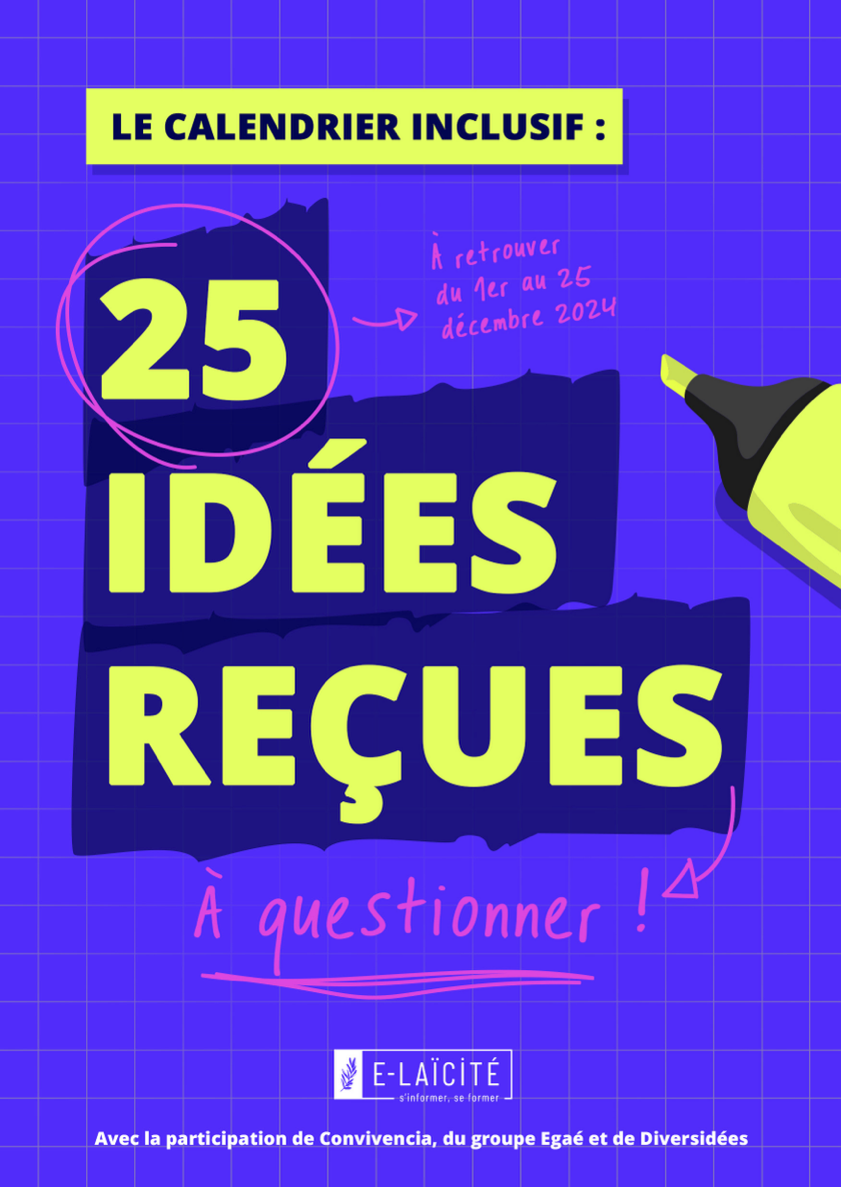Faire du prosélytisme au travail : une aberration ? Tour d’horizon du cadre applicable (privé/public) et exemples concrets de jurisprudence.
 L’adoption par le Sénat d’une proposition de loi visant à interdire les signes religieux ostensibles lors des compétitions sportives, au début de l’année 2025, a ravivé les débats désormais coutumiers en France sur la visibilité des convictions religieuses dans les espaces publics.
L’adoption par le Sénat d’une proposition de loi visant à interdire les signes religieux ostensibles lors des compétitions sportives, au début de l’année 2025, a ravivé les débats désormais coutumiers en France sur la visibilité des convictions religieuses dans les espaces publics.
Porté par des élus de droite comme un outil de défense de la neutralité et des valeurs républicaines, ce texte s’inscrit dans une rhétorique de lutte contre les « replis communautaires ». Néanmoins, cette volonté d’interdire les signes religieux dans le sport a fait l’objet de vives critiques, tant en France qu’à l’international.
Quelles règles s’appliquent aux signes religieux dans le sport ?
Les règles à l’international : une exception française ?
La position de la France sur les signes religieux dans le sport apparaît de plus en plus singulière au regard des usages internationaux. La tendance mondiale est en effet plutôt libérale : ainsi, la FIFA (football) a autorisé le port de couvre-chefs en 2014, suivie par la FIBA (basket-ball) en 2017, chacune jugeant que ceux-ci ne posaient pas de problème pour la pratique du sport.
Le Comité International Olympique (CIO), quant à lui, interdit toute forme de « démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale » sur les sites olympiques. Il faut noter que le terme « démonstration » est ici un faux-ami, traduction littérale de l’anglais “demonstration” qui renvoie à l’idée de manifestation ou de propagande. L’interdiction énoncée par le CIO vise donc les comportements actifs de promotion des convictions personnelles, et non le simple port d’un signe religieux (voile, kippa, turban) qui reste autorisé pourvu qu’il soit compatible avec les impératifs propres à chaque discipline. Cette distinction est d’ailleurs établie de manière similaire en droit français : le Conseil d’État rappelle régulièrement, par une jurisprudence constante, que le simple port d’un signe ne saurait être assimilé à du prosélytisme.
En France : des règles hétérogènes et contestées
À ce jour, il n’existe aucune interdiction générale des signes religieux dans le sport en France. Les règles applicables peuvent néanmoins varier en fonction du statut des sportifs : en effet, les athlètes sélectionné·es en équipe de France sont tenu·es à une obligation de neutralité, car on considère qu’ils et elles exercent une « mission de représentation de la Nation ».
Pour les autres licencié·es des clubs de sport, la liberté d’expression est le principe. Cependant, certaines fédérations ont décidé d’y déroger par leur règlement intérieur. Ainsi, les Fédérations françaises de football (FFF) et de basketball (FFB) interdisent le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. À l’inverse, d’autres comme la Fédération française de handball ou celle de rugby n’imposent aucune restriction de ce type.
Saisi par le collectif des « Hijabeuses » et d’autres associations contestant la légalité du règlement adopté par la FFF, le Conseil d’État a rendu une décision clé le 29 juin 2023. Alors que son rapporteur public, Clément Malverti, avait préconisé d’annuler l’interdiction, arguant qu’elle n’était justifiée par aucun trouble avéré et que la neutralité ne s’appliquait pas aux usager·es des services publics, la haute juridiction a retenu une autre lecture.
Le Conseil d’État a ainsi jugé que l’interdiction des signes religieux en compétition pouvait constituer une mesure « nécessaire, adaptée et proportionnée » afin de garantir le « bon déroulement » des matchs et de prévenir les « affrontements ». C’est sur ce fondement qu’il a validé l’interdiction édictée par la FFF, une justification qui ne repose que sur un risque purement hypothétique selon ses détracteurs, qui accusent le Conseil d’État d’avoir ouvert une « boîte de Pandore » en légitimant une conception extensive de l’obligation de neutralité..
Loi votée au Sénat : vers une interdiction des signes religieux dans le sport ?
Le 18 février 2025, le Sénat a adopté une proposition de loi visant à inscrire dans le marbre une interdiction générale. Le texte prévoit d’interdire « le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse lors des compétitions organisées par les fédérations sportives délégataires, leurs organes déconcentrés, leurs ligues professionnelles et leurs associations affiliées ». Il impose également le respect de la neutralité dans les piscines publiques.
Après des hésitations et des dissensions internes, le gouvernement Bayrou a finalement tranché et annoncé son soutien au texte, promettant son inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.
Pourquoi ce sujet divise-t-il autant ?
Les partisans d’une interdiction : Neutralité & Sécurité
Les tenants d’une restriction des signes religieux mobilisent plusieurs arguments. Le premier est celui de la laïcité et de la neutralité. Pour le sénateur Michel Savin (LR), auteur de la loi, il est temps de « sanctuariser le domaine sportif où la neutralité s’impose » afin que ces compétitions deviennent des espaces exempts de toute expression religieuse ou politique.
Un autre argument majeur est celui de l’égalité entre les sexes, le voile étant perçu par certain·es comme un symbole d’oppression. « Nous ne stigmatisons pas les jeunes filles, nous cherchons à les protéger », affirme ainsi le sénateur Max Brisson (LR).
La lutte contre le « communautarisme » et la « radicalisation » est également invoquée. Des responsables politiques comme Julien Odoul (RN) estiment que « le sport est une cible et un objet de conquête pour les Frères musulmans ». Cet argument est cependant contredit par le rapport SPORAD, commandé par le ministère de l’Intérieur en 2022, dont les conclusions indiquent qu’il n’y a « pas de phénomène structurel, ni même significatif de radicalisation ou de communautarisme dans le sport ». « Je ne conteste pas que ce sont des phénomènes qui ne sont pas très nombreux, mais le peu est déjà trop », rétorque Michel Savin à ce propos.
Enfin, les partisans de la loi mettent en avant la nécessité d’harmoniser les règles pour mettre fin aux différences entre fédérations. On peut toutefois considérer que cet argument serait plutôt de nature à plaider pour une autorisation générale des signes religieux en compétition, dans une démarche d’harmonisation non seulement entre fédérations françaises, mais également avec les standards internationaux.
Les opposants à l’interdiction : Libertés & Non-discrimination
À l’inverse, les détracteurs de cette interdiction s’appuient sur les équilibres juridiques fondant le principe de laïcité, par lesquels seuls les agents publics et assimilés sont tenus de respecter une obligation de neutralité, et non pas les usager·es des services publics et les citoyen·nes. Ainsi, selon l’historien Jean Baubérot, spécialiste de la laïcité :
« Vouloir que des sportifs représentant la France n’arborent pas de signe religieux est une chose ; imposer un principe de neutralité aux clubs sportifs est aussi absurde que de mettre sur un pied d’égalité un soignant à l’hôpital et le malade qui s’y rend. »
Ces opposant·es à la proposition de loi invoquent le respect des libertés fondamentales – notamment libertés de conscience et d’expression – garanties par la Constitution et les conventions internationales. Pour la Ligue des Droits de l’Homme, une telle loi serait discriminatoire car elle ciblerait particulièrement les femmes musulmanes, et pourrait les exclure de la pratique sportive. Le risque serait alors de renforcer l’isolement de ces jeunes femmes et de les pousser à rejoindre des clubs communautaires, nourrissant ainsi les « replis » que la loi prétend combattre.
Quels enjeux à l’avenir ?
Sur le plan juridique
 L’avenir de la proposition de loi votée au Sénat reste incertain, aucune date n’ayant été fixée pour son examen par l’Assemblée nationale à ce jour. Parallèlement, la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH), saisie par les « Hijabeuses » au sujet du règlement intérieur de la FFF, a jugé leur recours recevable et devrait rendre sa décision fin 2025. Celle-ci sera, à n’en pas douter, examinée avec la plus grande attention en France.
L’avenir de la proposition de loi votée au Sénat reste incertain, aucune date n’ayant été fixée pour son examen par l’Assemblée nationale à ce jour. Parallèlement, la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH), saisie par les « Hijabeuses » au sujet du règlement intérieur de la FFF, a jugé leur recours recevable et devrait rendre sa décision fin 2025. Celle-ci sera, à n’en pas douter, examinée avec la plus grande attention en France.
 L’une des questions posées à la CEDH concerne la potentielle dimension discriminatoire d’une prohibition du port de signes religieux dans le sport : en effet, une interdiction ciblant uniquement les signes portés, et non les autres formes d’expression religieuse, pourrait s’appliquer de manière disproportionnée aux femmes musulmanes portant le hijab. Pourtant, d’autres types de manifestation de leurs convictions religieuses sont courants chez les joueurs masculins, ainsi que l’a montré le Human Rights Centre de l’Université de Gand quant au football.
L’une des questions posées à la CEDH concerne la potentielle dimension discriminatoire d’une prohibition du port de signes religieux dans le sport : en effet, une interdiction ciblant uniquement les signes portés, et non les autres formes d’expression religieuse, pourrait s’appliquer de manière disproportionnée aux femmes musulmanes portant le hijab. Pourtant, d’autres types de manifestation de leurs convictions religieuses sont courants chez les joueurs masculins, ainsi que l’a montré le Human Rights Centre de l’Université de Gand quant au football.
Sur le plan sportif et social
L’interdiction des signes religieux dans le sport pourrait avoir des conséquences directes sur la participation de nombreuses sportives. Certaines pourraient être contraintes d’arrêter leur pratique, de se tourner vers des structures parallèles ou de s’expatrier. Ainsi, des athlètes de haut niveau, comme la basketteuse Diaba Konaté, ont déjà choisi cette voie pour poursuivre leur carrière.
Sur le plan social, Amnesty International alerte sur le risque de stigmatisation et de marginalisation, qui pourrait renforcer les dynamiques de tensions identitaires au lieu de favoriser l’intégration et la cohésion sociale.
Conclusion
La question des signes religieux dans le sport est révélatrice des débats profonds qui animent la société française, en interrogeant la manière dont la République peut articuler au mieux laïcité, égalité et inclusion. L’issue de ces débats, qu’elle soit législative ou judiciaire, aura quoi qu’il en soit des conséquences déterminantes sur la cohésion sociale.